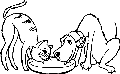|
Jeudi 24 janvier 2008 - 19h -
Amphithéâtre de l'Athénée municipal, Bordeaux, France
"ALZHEIMER : UU AUTRE REGARD..." / Conférences - débats
LES PERSONNES AGEES AU CONTACT DES
ANIMAUX :
LE COMPORTEMENT ANIMAL PEUT-IL NOUS AIDER A CONCEVOIR
UN AUTRE REGARD ET UNE AUTRE APPROCHE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ?
Communication de
Delphine DESCAMPS*, éthologue, publiée dans les Actes de la
Conférence "Alzheimer : un autre regard...", jeudi 24 janviers 2008, Bordeaux,
Amphithéâtre de l'Athénée municipal
(vous pouvez vous procurer les actes complets (avec DVD) auprés de
: ASSOCIATION VILLA
PIA,
52 rue des Treuils - 33000 Bordeaux,
www.cos-villapia.fr
/
infos@cos-villapia.fr,
05 56 96 13 59)
- Bref historique, quelques repères…
- Vous avez dit Ethologie ?
- Les Activités Associant l’Animal permettent le lien entre théorie et pratique…
- Concrètement, je vais vous faire part de quelques observations de terrain
- La relation zooludique entre les enfants et les chats
- La relation zooludique entre les personnes âgées et les chats
- Quelques remarques pour conclure à partir de ces observations…
Ethologue
titulaire d’un Master 2 (DEA) de Sciences Humaines et Sociales,
encadrant des activités associant l’animal auprès de personnes âgées en EHPAD
et auprès d’enfants.
www.etho-logis.fr /
http://delphine.descamps.free.fr /
delphine.descamps@etho-logis.fr
Au sein de nos sociétés actuelles occidentales, pour
beaucoup d’entre nous, l’animal est devenu un compagnon quotidien qui améliore
notre qualité de vie et participe à notre bien-être, tant physique que
psychologique.
De nombreuses études[2]
témoignent de l’apport bénéfique de l’animal sur la santé et le moral des
personnes âgées, prouvent qu’elles sont moins déprimées et restent alertes
plus longtemps grâce aux différentes stimulations : visuelle, tactile et
émotionnelle que procure un animal de compagnie.
- Dans le Missouri depuis plus de 10 ans, dans la maison
de retraite NHC, Susan Taylor autorise la présence de chiens, chats, lapins,
chevaux, oiseaux, etc. Elle accepte parallèlement les animaux des résidants à
leur arrivée au sein de la structure. Cette étude a montré que la présence
d’animaux dans l’entourage des personnes âgées permet d’éviter la mélancolie
et les stimule d’une manière toute aussi originale.
- Selon Rebecca Jonhson du centre de médecine vétérinaire
de l’Université du Missouri, « les animaux leur procurent un soutien et un
amour inconditionnel. On note également que les séniors âgés qui vivent avec un
animal marchent plus, ont un taux de triglycérides et de cholestérol nettement
plus bas et sont de meilleure humeur que les autres. Ils sont plus résistants
après une crise cardiaque. »
- Dans l’Indiana, les chercheurs de l’Université de
Lafayette ont noté le fait que les patients atteints de la maladie d’Alzheimer
retrouvent leur appétit en observant un aquarium contenant des poissons rouges.
- Une étude espagnole confirme cette thèse selon laquelle
« les animaux de compagnie améliorent le quotidien des personnes âgées ».
Les sentiments d’isolement et de dépression se trouvent être moins présents
chez ces individus.
- Prendre soin d’un animal augmente l’estime de soi de
ces personnes et peut aller jusqu’à réduire le risque de développer certaines
maladies : en 1983, Katcher et Friedmann confirment à travers leur étude
médicale que les caresses prodiguées à un animal réduisent la pression
artérielle et préviennent les maladies cardio-vasculaires, le diabète et
l’ostéoporose.
- Ainsi certains médecins préconisent la présence
d’animaux au sein d’établissements médicalisés.
Le Dr William Tuke, en Angleterre, est le premier, dès
1792, à constater que la présence des animaux auprès de personnes malades peut
les aider à guérir plus rapidement. Il crée l’Institut « York retreat »
accueillant des malades mentaux avec comme principe thérapeutique de prendre
soin d’animaux afin de responsabiliser les individus par rapport à autrui et
ainsi, leur faire prendre conscience de leur propre personne.
- Cependant, ce n’est que dans les années 50 que Boris
Levinson – psychologue pour enfants - utilise l’animal comme outil thérapeutique.
On pourrait le considérer comme le maître fondateur de la zoothérapie.
D’une manière plus globale, ce serait l’hypothèse de la
biophilie (attrait de la nature) qu’il faudrait confronter aux institutions
telles que des maisons de retraite ou des hôpitaux.
Ainsi, l’éthologie – étude du comportement- est une
science qui s’allie bien avec ces pratiques de mise en relation
interspécifiques. On distingue l’éthologie humaine de l’éthologie animale. Dans
ce contexte, il s’agit de l’analyse des relations entre l’humain et l’animal
avec les bénéfices et les contraintes réciproques.
L’éthologie utilise l’observation comme principal outil
de recherche et d’analyse. « Pour répondre aux différentes questions
qu’il se pose, l’éthologue se réfère au répertoire comportemental connu de
chaque espèce – l’éthogramme – de manière à proposer des hypothèses
rationnelles en rapport avec ce que l’on connaît déjà du comportement animal en
général et de l’espèce étudiée en particulier.
L’éthologue décrit, classe et mesure les
comportements observés. Il va ainsi répondre à quatre interrogations
de base : Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? »[3]
Individuelle ou collective, L’Activité Associant l’Animal
signifie la présence d’un animal domestique introduit par un intervenant
qualifié dans l’environnement immédiat d’une personne chez qui l’on cherche à
susciter des réactions visant à maintenir et/ou à améliorer son potentiel
cognitif, physique, psychosocial et affectif.
Le professionnel accompagnant l’animal doit avoir une
formation comportementale de l’animal concerné et les compétences nécessaires.
Il doit pouvoir interagir systématiquement avec le groupe aux cours des
activités.
Il doit posséder la capacité d’établir des programmes des
séances selon les objectifs fixés : activités à but éducatif, ludique,
stimulant, thérapeutique, etc.
Lors du déroulement d’une séance d’Activité Associant
l’Animal, l’intervenant et l’animal (ou les animaux) présent(s) ne forment
qu’une seule entité, une équipe œuvrant en concert avec un objectif commun. Il
est indispensable de ressentir cette collaboration.
Les séances d’animation à Villa Pia ont lieu soit avec des
personnes âgées, dont certaines sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, soit
avec un groupe d’enfants de 3 à 6 ans et de personnes âgées.
Lors d’Activités Associant l’Animal organisées avec des
enfants, nous avons tout d’abord comme objectif d’aboutir au respect de l’animal
en tenant compte de ses besoins et de ses exigences. Mais la relation
enfant/animal n’étant pas le thème principal de notre soirée, ni de ma
communication, je ne développerai donc pas ici cet aspect de mon travail à Villa
Pia, ni sa théorisation. Voici cependant quelques unes de mes remarques.
Pour que la présence d’un animal soit détachée d’un maximum
de danger, il faut tout d’abord que l’enfant apprenne à respecter les codes, les
signaux d’avertissement ou de menace de ce dernier. Par exemple, le toucher :
naturel et spontané chez l’enfant, il peut être perçu comme une agression par
l’animal s’il n’est pas régit par un rituel bien particulier.
De nombreux animaux peuvent être utilisés dans le cadre de
ces activités mais certains critères sont incontournables pour pouvoir envisager
de faire participer un animal à une telle activité : caractère, personnalité,
éducation, degré de socialisation, aspect sanitaire, tout ces critères
mériteraient d’être développés…
Généralement, les enfants sont calmes, attentifs et
portent de l’intérêt aux chats présents dans la même pièce qu’eux. Lors des
premières séances, les interactions interspécifiques étaient rares car les
enfants n’étaient pas très à l’aise, un peu effrayés. Il est arrivé que des
enfants se recroquevillent ou se reculent lorsque l’animal arrive trop vite ou
vient trop près. Ils restent alors ainsi légèrement à l’écart du groupe, plutôt
intrigués par le déroulement de la séance. Il s’agit là d’une certaine forme
d’appréhension faisant partie de la découverte de l’animal.
Mais au fil des séances, humains et félins ont mutuellement
trouvé leurs marques et pris des repères concernant cette activité. Nous pouvons
constater que la quasi-totalité des enfants caressent les chats – parfois
furtivement -, jouent avec eux et les observent jouer ensemble (jeu d’objet et
jeu de poursuite notamment). A plusieurs reprises, un des enfants a pris
un chat dans ses bras, lui fait des bisous en lui demandant comment il va.
Certains enfants miaulent ou se poursuivent à quatre pattes – jeu d’imitation
- pour attirer l’attention de l’un des chats ou bien les appellent pour qu’ils
viennent à eux. D’autres désignent les différents membres de l’animal tout en
les énumérant. Ils sont très curieux. Certains enfants ramassent les jouets des
chats et les regroupent avant de quitter la salle comme il le ferait dans leur
propre salle de jeux : ce qui prouve une certaine aisance.
Jusqu’à présent, les enfants n’ont jamais demandé à quitter
la salle. Il est même arrivé de les obliger pour laisser la place à leur
camarade.
Les enfants possédant des chats à leur domicile sont,
globalement, plus à l’aise durant l’activité. L’un d’entre eux, notamment,
manifeste un réel engouement. Actif, il montre de l’intérêt pour les chats et
fait preuve d’un élan instinctif en leur direction. Pourtant, il pourrait être
brusque dans ses mouvements à leur égard. D’où la nécessité d’une certaine
prudence quant à la manipulation de ces derniers. Tout animal reste à tout
moment imprévisible, pouvant être facilement effrayé par un son, une odeur ou
une vue inconnue. Mais la plupart du temps, les enfants sont doux et calmes en
présence des chats comme s’ils cherchaient à prendre soin, comme s’ils avaient
conscience de leur fragilité et de leur vulnérabilité (tout comme eux,
d’ailleurs).
Lorsqu’un enfant reste à l’écart du groupe par crainte,
l’atelier permet alors de le rassurer et de le mettre en confiance. Un temps
d’adaptation est nécessaire à toute nouvelle intrusion.
Ces observations sont la suite concrète de mon exposé
liminaire concernant la personne âgée et l’animal.
Les résidants sont contents de pourvoir caresser,
peigner ou prendre sur leur genoux les chats. Ils ont même des
éclats de rire en les regardant jouer, se prêtant au jeu ou simplement
éprouver du plaisir à les sentir se frotter à eux. La chaleur et
la douceur sont les remarques les plus récurrentes. Ainsi que la beauté de
l’animal.
Ils sont particulièrement touchés lorsque le chat
ronronne à leur contact.
Le calme et la tendresse des résidants permettent de
mettre en confiance l’animal.
Tous ces petits gestes simples, font travailler les
articulations et les muscles des résidants sans même qu’ils en aient
conscience et de manière ludique.
Souriants et attentifs aux déplacements des chats,
certains résidants participant à l’activité semblent établir une certaine
forme d’interaction et de communication directe avec les chats.
Une autre résidente, après un long moment passé avec 2 ou
3 chats sur ses genoux, est devenue beaucoup plus calme, a eu un long moment
de lucidité durant lequel elle a raconté des éléments –s’avérant véridiques-
de sa vie passée, retrouvant un moment une partie de sa mémoire.
Une autre résidente, bougeant et parlant très peu, le
regard très souvent dans le vide, s’est « éclairée » peu à peu, a pu
bouger sa main, pointer son doigt vers le chat et le caresser.
La séance suivante, il semble qu’elle se soit reconnue
sur une grande photo (A3) représentant cette situation.
-
La visite régulière, plusieurs fois par semaine, des chats de
l’association « Etho-Logis » au sein de l’institution se révèle avoir des
conséquences particulièrement bénéfiques sur les résidants.
-
Que ce soit auprès des enfants ou auprès des résidants âgés,
l’atelier éveille les sens. Restant prévenants et doux à leur égard, nous
pouvons témoigner d’une sincère affection des individus à l’égard des chats.
Même s’ils se plaisent à les regarder, le contact est régulièrement sollicité
(caresses et toucher).
-
Récemment, à l’initiative d’Elodie, étudiante animatrice stagiaire à
l’association, nous avons mis en place des lectures en rapport avec les
animaux et plus particulièrement les chats, appropriées aux enfants ou aux
personnes âgées dans le but de conserver plus longtemps la
concentration des résidants en variant le contenu de l’activité et faire
exprimer la personne à partir d’un texte. Ainsi, une résidante, ayant
reconnu la chanson « La mère Michel », a repris quelques paroles avec nous.
-
Des sourires se dessinent sans aucune retenue, des yeux s’illuminent de
bonheur et d’émerveillement et une communication bien spécifique, spontanée,
s’établit entre certains résidants et les félins mis en leur présence.
-
L’animal ne parle pas, ne juge pas….
-
Le temps de l’activité, la personne met de côté ses problèmes de santé
physique ou psychologique et s’abandonne à des échanges totalement libres avec
l’animal présent.
-
Des individus vont entrer en communication durant l’activité alors qu’ils
ne s’adressent pas la parole en dehors ou bien simplement pour se faire des
réflexions désagréables et des réprimandes.
-
La mise en place de différentes activités Ethologie, au sein de
l’institution, rythme le quotidien des résidants et permet à certains de
retrouver un espace temporel qu’ils avaient perdu.
-
Lorsque la communication verbale est possible, nous en profitons pour
demander à la personne de se remémorer les animaux qui ont pu faire partie de sa
vie antérieure. Certains nous montrent même des photos qu’ils gardent toujours
précieusement dans leur portefeuille après quinze ans de disparition de
l’animal…
-
Ainsi, l’animal se présente comme un stimulant
- pouvant
faire surgir certains souvenirs enfuis que la personne elle-même pouvait croire
oubliés,
- pouvant
provoquer une réaction quelle qu’elle soit : un mouvement de la main pour tenter
de caresser l’animal, un regard pour le regarder jouer, etc.
-
Quelque part « réanimée », la personne peut se sentir à nouveau
utile, nécessaire pour quelqu’un ou quelque chose. Dans un nouvel
état d’esprit, elle est plus détendue et moins agressive, elle peut alors
redonner du sens à son existence et créer – ou recréer – des liens avec son
entourage, qu’il s’agisse des membres de sa famille, des autres résidants ou des
salariés de l’institution.
-
Nous avons constaté également une diminution significative de la
détresse, de la tristesse et du repli sur soi, même s’il ne s’agit
pas d’un effacement complet ni permanent.
Nous souhaitons pouvoir continuer ces Activités Associant
l’Animal ainsi que les observations et la recherche en éthologie qui en
découlent, afin de participer ainsi très modestement au projet de
l’établissement et en particulier de vérifier si le comportement animal peut
nous aider à concevoir un autre regard et une autre approche de la maladie
d’Alzheimer.

*Ethologue et sociologue,
Delphine DESCAMPS a poursuivi
des études
en sciences humaines et sociales à Bordeaux 2 et Paris V La Sorbonne.
Licenciée en sociologie,
elle a obtenu une Maîtrise (Master1) de
sociologie.
Membre du laboratoire LABSAH à la
Sorbonne, Université de Paris V,
elle a obtenu, sous la direction du Professeur Jacques Goldberg,
un DEA (Master 2) d’Ethnologie, spécialité Ethologie.
En parallèle à ses activités de
recherche, d’observation et de conseil en comportement, Delphine
DESCAMPS pratique actuellement
au sein de l’association ETHO-LOGIS
des Activités Associant l’Animal
en institutions avec divers types de
publics,
en particulier des enfants,
des séniors, des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
Elle a par ailleurs étudié la langue des
signes et s’intéresse également à d’autres formes de handicap.
L’approche Snoezelen, La communication
sensorielle et non verbale,
nécessitant, en plus d’un savoir faire, des qualités d’empathie et de
"savoir être", est pour Delphine DESCAMPS une approche
éthologique de la personne.
Ginette Espagnac
Présidente de l'association Etho-Logis
|